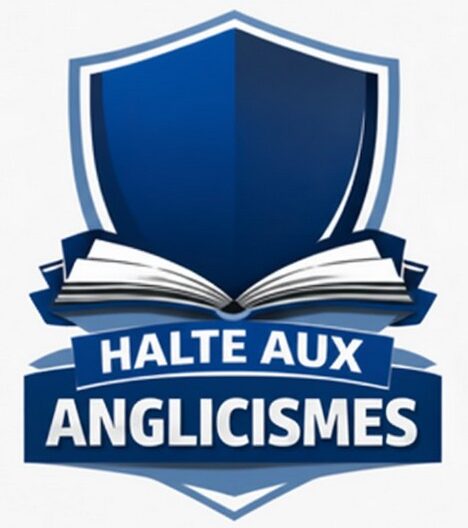C’est le titre de l’article dont nous gratifie La Dépêche aujourd’hui.
« Iconique » et « flagship », deux anglicismes pour une marque française bien connue, mais au nom à consonance anglaise : K-Way

Iconique a déjà été traité sur ce site

Il suffit de le remplacer par « emblématique », « caractéristique », « reconnaissable », « célèbre », « fameux », « historique », etc.
En employant l’abominable « iconique », La Dépêche rejoint la tribu de ce que j’appelle les iconiqlastes, nouvelle version des iconoclastes chers au capitaine Haddock.
Voir l’article : Icône, icône… est-ce que j’ai une gueule d’icône ?
D’où vient « flagship » ?
De « flag » (drapeau) et de « ship » (bateau). « Le navire occupé par le commandant de la flotte (généralement un amiral) est reconnaissable au pavillon qu’il arbore. » (Wiktionnaire)
Donc, en français, il s’agit tout simplement du navire amiral : « Le terme correspondant dans les marines britannique et américaine est « flagship », qui signifie « navire du pavillon » car, jadis, chaque amiral possédait son propre pavillon personnel qu’il faisait hisser sur le navire amiral. » (Wikipedia)

Je suis consternée de voir le mot anglais « flagship » utilisé par un journaliste français, comme si de rien n’était. Quand j’ai commencé ma carrière, il y a 30 ans, personne n’aurait songé à l’utiliser dans un texte français, car personne ne l’aurait compris. Cela montre le chemin parcouru par l’anglais dans notre pays, par la voie insidieuse du commerce et du pseudo-journalisme.
Par quoi remplacer « flagship » ?
Généralement, par « phare« . Donc, « magasin flagship » devient tout simplement « magasin phare« .
Mais on peut aussi utiliser « amiral » (magasin amiral), pour reprendre la notion de « navire amiral ». Ainsi que « fleuron » (magasin fleuron), pour exprimer « ce qu’il y a de plus précieux ».
Le créateur de K-Way, Léon-Claude Duhamel, précurseur de l’anglicisation de notre pays et de nos marques
Au début, tout allait bien : en 1965, « il nomme son coupe-vent en nylon « En-cas » (de pluie) et la pochette est séparée du vêtement. »
Mais ensuite, « l’année suivante, Léon-Claude Duhamel renomme, après des mois de débats, sous l’impulsion de l’agence Havas, dirigée par monsieur Castaing, son « en-K » en « K-way » (le terme « way » plus tendance, évoquant l’American way of life), ce qui lui donne une dimension internationale ; les publicités parlent d’un produit léger et coloré, et sous-entendent une origine américaine. » (Wikipedia)
Ah ! La dimension internationale octroyée par l’utilisation de l’anglais ! Que de dégâts pour notre langue et notre culture !